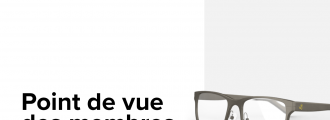Qui parlera pour le Canada?
Publiée dans The Hub (Who will speak for Canada?
De temps à autre, dans les moments où notre pays tente de s’engager dans une forme de dialogue national, comme une élection fédérale, on nous rappelle qu’il est facile de répéter le dernier refrain de nos incompréhensions et nos défaillances collectives.
Dans un article qui porte à réfléchir publié la semaine dernière sur le site The Hub, Howard Anglin a fait valoir que les résultats de l’élection fédérale démontrent encore une fois que notre pays est divisé en de nombreuses solitudes.
« Aux deux extrêmes, dans certaines parties des Prairies et au Québec, les différences sont si grandes que l’un est tenté de conclure qu’il ne s’agit plus d’une question de mal comprendre l’autre, mais plutôt une question de ne plus vouloir essayer de comprendre l’autre », écrit M. Anglin.
Et lorsqu’on se penche sur les chiffres, c’est difficile de lui donner tort. Quatre Canadiens, admissibles à voter, sur cinq ont choisi de ne pas voter pour le parti vainqueur lors de l’élection fédérale de la semaine dernière.
En fin de compte, 32,6 % des 62,2 % de Canadiens qui se sont rendus aux urnes ont voté pour le Parti libéral du Canada, ce qui représente moins de 20 % des électeurs admissibles.
La distribution des sièges illustre une saisissante division régionale/rurale/urbaine. Les conservateurs n’ont remporté aucun siège dans les trois plus grandes villes canadiennes, soit Toronto, Montréal et Vancouver. De la même manière, les libéraux n’ont pas été concurrentiels dans environ un tiers des circonscriptions, pour la plupart situées dans l’ouest de l’Ontario.
On dit souvent que le Canada est une expérience inachevée. Dans le meilleur des cas, notre diversité, dont témoigne notre fédéralisme, engendre une tension saine et rend possible une gouvernance raisonnée et pragmatique. Dans le pire des cas, le Canada est vu comme une chicane de famille sans fin.
Comme des frères et sœurs qui ne s’entendent pas, nous nous assoyons autour de la table en silence et nous mangeons le plus rapidement possible pour pouvoir retourner chacun dans notre chambre. L’immensité de notre pays fait en sorte qu’il est facile de s’ignorer les uns les autres.
Étant né et ayant été élevé au Québec, j’ai regardé les fédéralistes québécois briguer des sièges au Parlement fédéral dans le seul but d’exiger davantage de «pouvoirs» pour le gouvernement du Québec en se préoccupant très peu de ce que le gouvernement fédéral peut faire de bien dans son propre champ de compétence. Ils sont tellement obnubilés par leur désir de revendiquer plus pour le Québec qu’on est en droit de se demander pourquoi ils ne choisissent pas plutôt de briguer un siège à l’Assemblée nationale.
J’ai toujours eu du mal à comprendre qu’un fédéraliste qui veut représenter le Québec au Parlement du Canada puisse affirmer que le gouvernement fédéral n’a que peu ou pas de pertinence et de valeur dans la vie de ses concitoyens. Il est également ardu d’expliquer aux Canadiens des autres provinces pourquoi ils devraient avoir moins d’influence dans la vie des Québécois que les Québécois en ont dans la leur.
Avec tout l’argent dépensé et tous les engagements financiers pris par le gouvernement fédéral au cours des 18 derniers mois, on se demande bien pourquoi nous sommes toujours si loin de remplir nos obligations internationales en matière de défense et d’aide internationale et pourquoi nous sommes tenus à l’écart d’accords stratégiques comme celui que l’administration Biden vient tout juste de signer avec le Royaume-Uni et l’Australie.
En ce qui concerne l’unité nationale, nombreux sont ceux qui croient que la réponse se trouve quelque part au croisement de la décentralisation et de la centralisation de notre fédération. Si seulement nous pouvions «décentraliser» et donner davantage d’argent et de pouvoirs aux provinces, ou si seulement le gouvernement fédéral pouvait intervenir avec plus de fermeté dans les champs de compétence provinciaux comme la santé et l’éducation, tout irait bien.
Il s’agit là d’un débat légitime, mais je pense qu’il ne tient pas compte de notre manque d’unité nationale. Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un mélange d’ambition et de détermination, et de prendre conscience que la voie à suivre sera cahoteuse. Je serais prêt à parier qu’un programme ambitieux ancré dans les pouvoirs fédéraux qui transcenderait l’esprit de clocher conviendrait bien aux Canadiens.
Quand le président John F. Kennedy a mis au défi ses concitoyens d’envoyer un homme sur la Lune en septembre 1962, c’était un sujet pertinent pour tous les Américains. Il a également reconnu que ce défi en valait la peine non pas parce qu’il était facile, mais bien parce qu’il était difficile à réaliser. À un moment donné, quelqu’un doit se lever pour parler de ce que le Canada peut faire. S’obstiner constamment à affirmer que nous avons de moins en moins de choses en commun ne mènera qu’à un amas de ruines.
Il semble que notre pays est loin d’être à court d’engagements conséquents à prendre en considération. Donner un sentiment d’avoir un but à atteindre aux Canadiens permettrait de laisser un peu de côté les guerres de compétence entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et les tensions régionales actuelles.
Nous pourrions mettre en place un ambitieux programme de croissance économique à long terme afin de nous assurer que le niveau de vie des Canadiens ne diminue pas au fil du temps. Benjamin Friedman, économiste à Harvard, a écrit dans The Moral Consequences of Economic Growth : [Traduction] « La croissance économique, qui se traduit par une augmentation du niveau de vie de la vaste majorité des citoyens, engendre la plupart du temps de meilleures occasions, une plus grande tolérance face à la diversité, une meilleure mobilité sociale, un engagement plus ferme à l’égard de l’équité et un plus grand dévouement à la démocratie ».
En matière d’affaires mondiales, le temps est venu de laisser derrière nous notre nostalgie de l’idéalisme Pearsonian et d’aller de l’avant pour définir nos priorités nationales et pour agir afin de les réaliser en cette nouvelle ère géoéconomique. La fin du consensus de Washington est assurément l’un des plus importants défis auxquels le Canada a fait face au cours des cinquante dernières années sur la scène mondiale. Tandis que nous célébrons le retour de Michael Spavor et de Michael Kovrig, nous devons tirer de difficiles leçons de ce nouvel ordre mondial du chacun pour soi.
Nous pourrions aussi faire du Canada l’une des économies les plus novatrices au monde en nous appuyant sur la science et la technologie. Nous avons l’occasion de nous attaquer à des défis considérables comme les changements climatiques et de créer de la richesse pour des millions de Canadiens. Malgré leur petite taille et leur population dense, les Pays-Bas produisent beaucoup plus de nourriture qu’ils n’en consomment. C’est ainsi qu’une nation qui, à une époque, crevait de faim sous le régime nazi, est devenue un chef de file mondial en matière de techniques de culture et d’agriculture. Il n’y a aucune raison pour que le Canada ne puisse pas tirer profit de l’ingéniosité de son secteur privé et devenir un chef de file mondial dans trois domaines technologiques : les technologies propres, les technologies d’agriculture et les technologies bioscientifiques.
Faisons donc le choix de nous consacrer à des défis ambitieux plutôt que de perdre notre temps avec d’amères récriminations et des prophéties autoréalisatrices au sujet de guerres régionales et identitaires. Il est temps de parler de ce que le Canada peut accomplir.